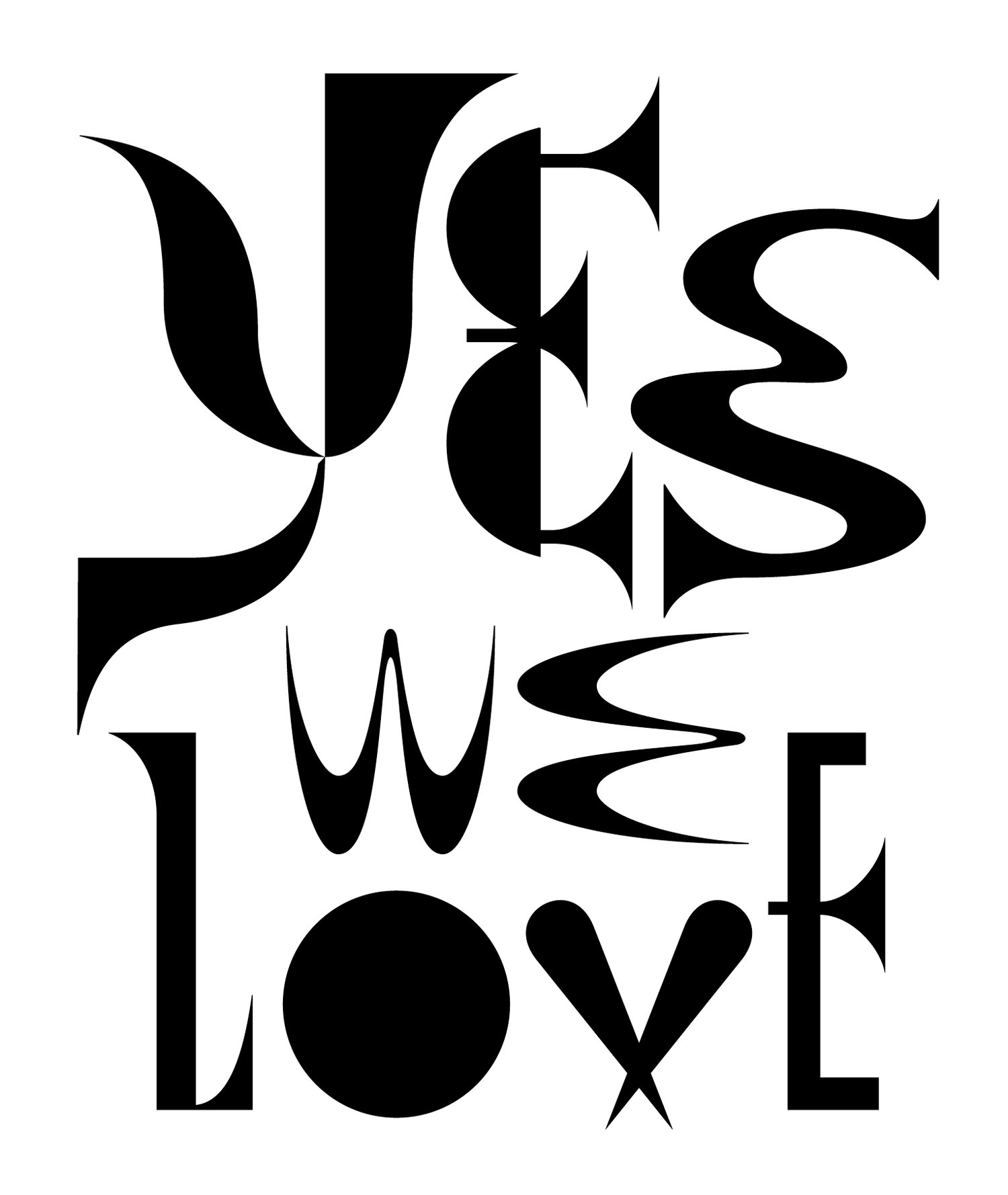Yvon Taillandier.
Un précurseur dans les années 1970
30 janvier — 27 février 2021
Galerie Patricia Dorfmann
61 rue de la verrerie
75004 Paris, France
Une vie d’aventure. C’est la pensée qui surgit à la lecture des mémoires d’Yvon Taillandier. Un homme qui occupe une place à part dans le paysage artistique du XXe siècle. Successivement peintre, sculpteur, écrivain, critique d’art, essayiste, voyageur et collectionneur. Il n’a cessé toute sa vie de ne pas choisir et de se laisser vivre au fil de ses rencontres.
Né à Paris en 1926, il quitte à l’âge de neuf ans la capitale et part vivre chez ses grands-parents maternels à Saint-Rambert-l’Île de Barbe au bord de la Saône. À douze ans, il montre ses dessins à Henriette et Jean Couty, artistes de la région, qui lui font rencontrer Renaux Icard, un antiquaire érudit, collectionneur avisé et résistant de la première heure. Renaux Icard prend sous son aile le jeune adolescent. Yvon Taillandier va tout apprendre de cet homme fin lettré. Il va se nourrir de sa bibliothèque, de sa collection d’art et des rencontres qu’il fait chez lui. Nombreux intellectuels de l’époque quittent Paris pour se réfugier en zone libre. Renaux Icard les aide et les accueille chez lui pour des séjours, des déjeuners et des dîners. Yvon Taillandier y fait des rencontres qui enrichissent ses connaissances littéraires et développent chez lui une passion pour la philosophie. Il rencontre entre-autres Pierre Klossowski, Stanislas Fumet, Pierre Leyris et Jean Wahl. En pleine Deuxième Guerre Mondiale dans une France occupée et divisée en deux où les musées sont clos, c’est au travers de ces nouveaux amis qu’Yvon se forge une première éducation artistique. En mars 1944, Yvon Taillandier échappe de peu à une arrestation par la Gestapo alors qu’il se rend à un rendez-vous chez son ami l’Abbé Larue. Ce dernier qui s’apprêtait à recevoir Louis Aragon sera fusillé par les Allemands. Vers la fin de l’occupation, il fait la rencontre, à l’occasion d’une fête chez le sculpteur Marcel Gimond, de la famille Selz et de Christiane Bailly qui l’incite à partir à Paris pour assister à une conférence de Fernand Léger à la Sorbonne.
En 1945, à l’âge de dix-neuf ans, Yvon Taillandier quitte Lyon, s’installe à Paris chez Jacqueline Selz, rue Victorien-Sardou dans le 16e arrondissement et y reste pendant cinquante six ans. Pendant cette période, curieux, il ne cesse de partir à la rencontre des artistes et des intellectuels de son temps. Pour l’aider, des amis de Jacqueline lui commandent des textes critiques. Yvon Taillandier se prend de passion pour l’écriture et la critique d’art. Remarqué par le critique d’art Gaston Diehl, Président fondateur du Salon de Mai, il se voit confier une importante exposition sur Gauguin. Il est nommé secrétaire du comité du Salon de Mai en 1947, une fonction qu’il occupe pendant quarante-quatre années. Le prestigieux salon de Mai se tient chaque année. Yvon Taillandier y fréquente d’innombrables artistes. Il écrit sur ces artistes qui deviendront de fidèles amis : Marcel Pouget, Paul Rebeyrolle, Pierre Soulages, Jean Dubuffet, Georges Braque, Robert Couturier, Émile Gilioli, Marcel Gilli, Claude Gilli, Henri Laurens, Charles Semser, Hugh Weiss, Atila Biro, Baltasar Lobo, Alexander Archipenko, François Stahly, Joan Miro, James Jacques Brown, Marc Chagall, Alfred Manessier, Géza Szobel, Isabelle Waldberg, Etienne Martin, Jacques Villon, Serge Poliakoff, Pierre Dmitrienko, Wifredo Lam, Gilles Aillaud, Jean Bazaine, Guðmundur Guðmundsson (dit Erro), Édouard Pignon, Félix Labisse, Lucien Coutaud, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Antonio Segui, Victor Brauner, Valerio Adami, Pinchas Burstein(dit Maryan), Pierre Alechinsky, Antonio Saura, Edouardo Arroyo, Pablo Picasso, Jacques Doucet, Roger Edgar Gillet, Jean Messagier, André Derain, Gérard Tisserand, César Baldaccini (dit César), Roberto Álvarez Ríos, Ladislas Kijno....
Il entretient une relation amicale particulière avec les artistes Joan Miro, Alberto Giaccometti, Pierre Soulages et Ladislas Kijno. Il fréquente assidûment les milieux artistiques et côtoie des écrivains et poètes, (Marguerite Duras, Michel Leiris, Alain Robbe-Gillet, Philippe Sollers, André Pieyre de Mandiargues, Alain Jouffroy...) mais aussi des cinéastes (François Truffaut, Robert Bresson...), des photographes (Édouard Boubat, Emmanuel Radnitsky (dit Man Ray), Marc Riboud, Sabine Weiss...) et des musiciens (Pierre Henry, Pierre Boulez...).
Yvon Taillandier devient un critique d’art réputé. Certains de ces écrits annoncent avec dix ans d’avance des mouvements artistiques. Il collabore pendant plusieurs années avec de nombreuses revues comme Connaissance des Arts ou XXe Siècle. Il écrit également pour les revues Opus, L’œil et Konstrevy. En 1968, il cesse son activité de critique d’art pour des revues. Il écrit exclusivement pour ses amis artistes mais il s’aperçoit alors qu’il ne prend plus de plaisir à écrire pour les autres. Yvon Taillandier décide alors de raconter ses histoires en dessins. Il publie dans des revues ses reportages dessinés qu’il appelle « Nouvelle Critique ».
Durant toutes ces années où il est historien d’art, il publie de nombreux articles, textes critiques ou théoriques, des interviews et des monographies. Il écrit pour les autres et pour son propre plaisir. Il devient l’ambassadeur de l’Art de son temps et voyage à travers le monde. En 1968, il est conférencier pour l’Unesco à Cuba, en 1970 il est nommé commissaire artistique de la Biennale de Katmandou au Népal, en 1973, il est invité par le gouvernement Indien en tant que commissaire artistique. À l’occasion de ces déplacements en Europe, en Amérique et en Asie, il constitue avec sa compagne d’alors, Jacqueline Selz, une collection d’art naïf et populaire impressionnante.
« C’est à ce moment là, en 1970, quand j’ai été nommé par Gaston Diehl commissaire artistique français à la biennale de Katmandou, qu’émerveillé par l’architecture des maisons népalaises et par la beauté des décorations de leurs portes, j’ai acheté du papier de boucherie, qui en fait était du très beau papier d’Extrême-Orient de format raisin. Je commençai des compositions où figuraient des petits groupes de religieux serrés autour d’un instrument de musique et, pour combler les vides, je fis appel à mes Taillandiers-landais qui n’hésitèrent pas à m’obéir : les amoureux de la hauteur et, pour occuper ceux qu’il y avait en largeur ; se présentèrent les horizontalistes et les centaures très améliorés possédant dix ou quinze jambes. »
Yvon Taillandier est un fin observateur. Il est le spectateur de la vie grouillante de l’art de l’époque. Il passe des heures chez les artistes à discuter et observer leurs œuvres. Multipliant les interrogations de toutes sortes concernant la technique, l’inspiration, la philosophie et la vie de ces derniers, il s’applique souvent à remplir des pages entières de son journal personnel, retranscrivant ses échanges avec les artistes et pastichant les toiles et les dessins découverts dans les ateliers.
« Tout ce qu’on invente est vrai » disait Gustave Flaubert.
À partir de 1969, Yvon Taillandier s’adonne au dessin et à la peinture. L’œuvre qu’il développe se caractérise par une immense liberté et une extraordinaire diversité des formes. Ses rencontres avec les intellectuels et les artistes de son temps, ses nombreuses lectures, ses voyages à travers le monde et la société en pleine transition, marquée par des mouvements politiques et sociaux et où la société de consommation triomphe, sont pour lui une abondante source d’inspiration. Il donne naissance à un univers envahi de personnages qui évoluent, se développent et se transforment au fil de son œuvre. Il aborde son art pictural à la manière d’un littéraire. Emprunt à la bande dessinée, son monde se déploie comme un récit à la fois narratif et figuratif.
— Lucas Djaou, décembre 2020.