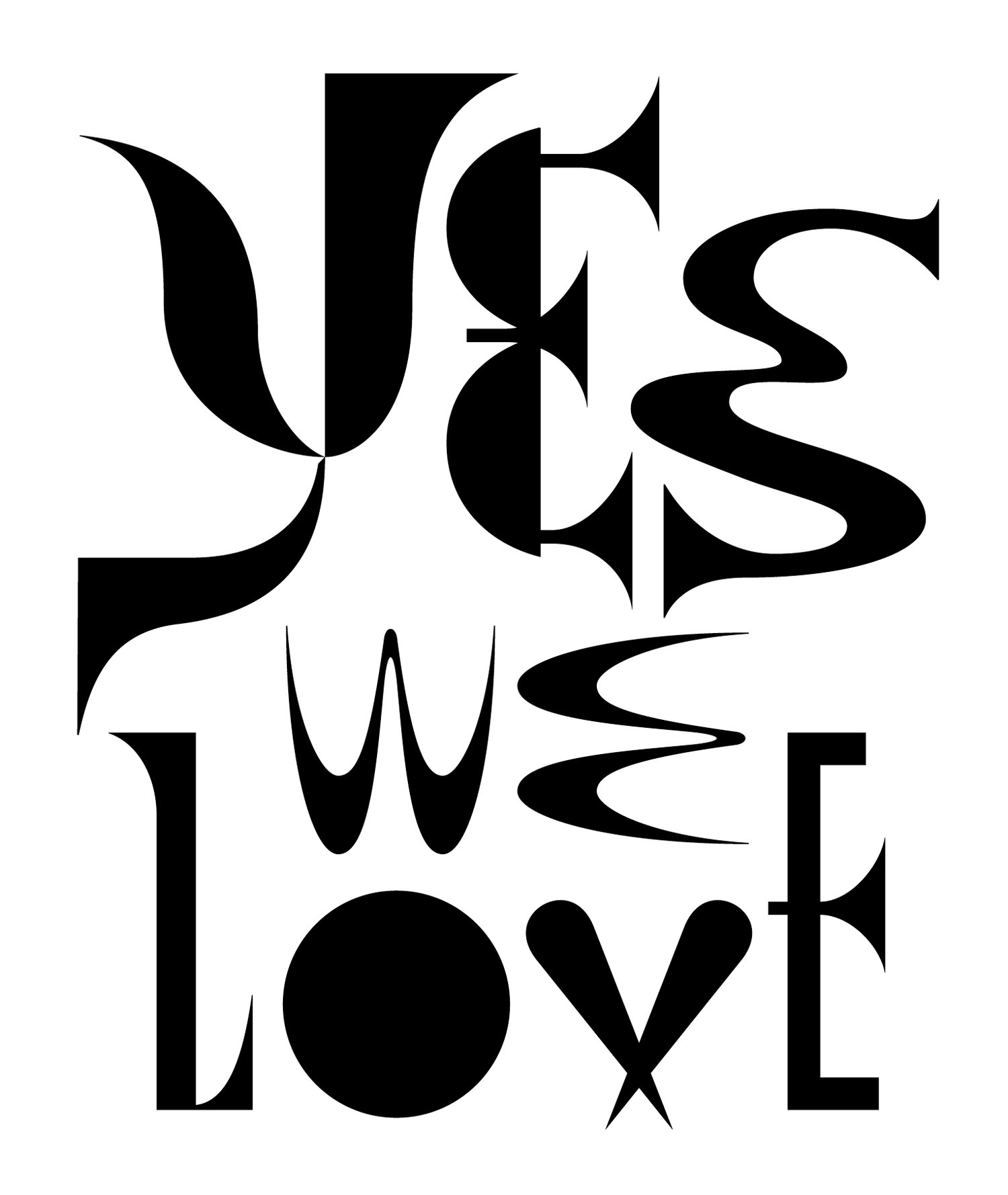Maryan.
Une peinture vérité.
31 mars — 28 mai 2022
Galerie Kamel Mennour
47 rue Saint-André-des-Arts
75006 Paris, France
Né en 1927 au sud-est de Cracovie dans une famille juive polonaise, Pinchas Burstein ne pouvait traverser qu’avec heurts et fracas le conflit le plus meurtrier du XXe siècle - dont il fut seul rescapé parmi les siens. Celui qui se fit plus tard connaître sous le nom de Maryan S. Maryan laissa derrière lui une œuvre dont la puissance chromatique et stylistique fut souvent perçue comme un miroir déformant de son histoire personnelle. Son art ne fut pourtant pas une revanche sur les évènements et l’artiste refusa toujours que son œuvre soit comprise au seul prisme de son expérience concentrationnaire. « La plupart de ce qu’on a écrit sur moi, c’est du bidon » écrivait-il l’année de sa disparition. De sa première exposition à Jérusalem en 1949 à sa disparition brutale en 1977 à New York, Maryan fit de l’art un moyen cathartique vital, sans haine mais non sans clairvoyance. Ce qu’il peignit fut moins un témoignage de son passé que celui du destin brutal et émouvant de l’Homme. Longtemps oublié, bien que considéré par ses pairs comme le père de la Nouvelle Figuration, Maryan ne fut pas un artiste témoin, ni un artiste fou ; son délire s’arrêtait au pinceau. Ni militant, ni porte-parole d’une cause, Maryan chercha à donner à voir le monde tel qu’il le vécut, le perçut et, certainement, tel qu’il est réellement.
Dans les années 1950, il vit à Paris, où la mode est à l’abstraction. Il fréquente les artistes de la scène artistique d’alors, de l’École de Paris à Cobra, au contact desquels il compose une peinture que l’on pourrait qualifier de « figurative expressionniste » dans le sillon du français Jean-Michel Atlan et du mexicain Rufino Tamayo. En 1961, l’exposition Nouvelle Figuration organisée par le galeriste Mathias Fels met en lumière le renouveau du courant figuratif qui se développe alors en Europe. Sur les cimaises, les œuvres de Maryan côtoient celles de Karel Appel, Francis Bacon, Alberto Giacometti ou encore Jean Dubuffet.
L’arrivée de Maryan aux États-Unis en 1962, puis sa naturalisation comme citoyen américain en 1969 marquent l’entrée dans une nouvelle période, caractérisée par la découverte d’un mode de vie consumériste – l’American way of life. L’expressionnisme abstrait se retire alors de la scène artistique et l’époque est au Pop art, auquel Maryan est des plus attentifs. Il observe minutieusement ce mouvement artistique qui, loin de se limiter à la seule sphère culturelle, se transforme en véritable phénomène de société. Cette découverte opère un changement de paradigme majeur dans son travail : Maryan s’épanouit dans sa vie new-yorkaise, il développe une peinture personnelle nourrie d’influences multiples, populaires et folkloriques. Cet éclectisme original contribue à forger le style « maryanesque » désormais si reconnaissable.
Souvent sans titre, les tableaux de cette période sont peuplés de personnages solitaires tous vêtus de vêtements extravagants, comme exposés à la vue de tous sur une scène de théâtre. Si beaucoup sont anonymes et non identifiés, il est cependant possible d’y voir des autoportraits, masqués derrière de larges lunettes. Parmi le fourmillement des personnages se trouvent des membres du Ku Klux Klan – la société secrète terroriste suprémaciste blanche connaît un regain d’activité dans l’Amérique des années 1960 –, des inconnus en costume cravate – banquiers de Wall Street ou hommes d’affaires –, des personnages à la bouche remplie de sucres d’orge, des figures rieuses ou moqueuses. Certains anonymes portent un bonnet d’âne, d’autres arborent des coiffes leur tombant dans les yeux : leurs chapeaux tantôt melon tantôt pointus, cabossés, déformés voire surdimensionnés sont de lointains échos à ceux des Pénitents de Séville. Ils évoquent aussi les œuvres de Diego Rodríguez, Francisco de Goya et Frans Hals, que Maryan admirait. Si elles dressent une satire mordante de la société, ces créations semblent avant tout inspirées par le quotidien de l’artiste ou par des chocs esthétiques inattendus, telle la série des personnages déguisés en Napoléon (inspirés d’une statuette de l’empereur offerte par un ami collectionneur) ou les surprenantes scènes de corridas réalisées après des séjours en Espagne, dans lesquelles le bourreau fait face à sa victime.
L’ensemble se déploie en une étonnante galerie de portraits cocasses, caricaturaux, grotesques et colorés, où les personnages successivement crient, sourient, rient, grimacent, se goinfrent de sucreries, vomissent, tirent la langue, se cachent sous des masques voire exhibent leurs parties génitales. Le monde pictural de Maryan est peuplé de personnages étranges et curieusement attachants. Sous son pinceau, l’art est modelé à l’image de l’homme : il se présente au regardeur de manière aussi triviale que grandiose. De fait, ses personnages semblent surgir d’un univers carnavalesque acide et émouvant. C’est une grande fête, une mascarade, une incroyable « ménagerie humaine » qui s’expose, d’après l’expression de l’artiste. En cela, la peinture de Maryan nous saisit dans notre plus profonde intimité. Parce qu’elle dérange, provoque et attendrit, elle nous rappelle la cruelle vérité que l’homme est un animal, écartelé entre ses émotions contraires et changeantes. La multitude de symboles et d’histoires que donne à voir son œuvre forme une « synthèse de l’ensemble des manifestations populaires de l’humanité », selon la formule employée à l’occasion de l’exposition Hommage à Maryan (1978), organisée à la Galerie de France.
Ces « manifestations populaires » puisent à des sources d’une étonnante variété, du chatoiement des costumes folkloriques, que l’artiste a pu observer lors de fréquentes visites au Musée de l’Homme, au graphisme anguleux de l’art qu’on qualifie alors de « tribal », que Maryan collectionne. De Paris à New York, au sein des lieux de vie de Maryan – lieux de passage, hôtels ou appartements – les objets occupent une place particulière. C’est au mythique Chelsea Hotel, où réside et s’exprime la bouillonnante scène artistique new-yorkaise, que Maryan s’installe fin 1973. Son appartement se dévoile sur les photographies prises par son galeriste Allan Frumkin en 1977 : le lieu regorge d’objets hétéroclites et d’œuvres d’art. L’artiste s’est créé un musée personnel où ses propres créations dialoguent avec des objets insolites provenant du monde entier. Cheval à bascule polonais, robot à pile japonais, marionnettes en bois, distributeurs de chewing-gum, masques rituels ou populaires, poster de Marilyn Monroe, céramiques mexicaines, figurines Disney, comics, icônes religieuses : ce formidable rassemblement d’une absolue disparité esthétique fut le terreau fertile duquel émergea l’univers fantastique de Maryan.
Le 15 juin 1977, l’artiste succombe à une attaque cardiaque dans son appartement new-yorkais. De ses cinquante années d’existence, il lègue un héritage artistique complexe à l’esthétique pionnière. L’univers qu’il s’est créé, les personnages qu’il a inventés, la société qu’il a caricaturée constituent des images singulières de l’époque qu’il a traversée. Fabuleux coloriste, dessinateur hors pair, il contribua au développement d’une manière picturale aujourd’hui rendue célèbre par des artistes comme Peter Saul, Keith Haring, Robert Combas ou Philip Guston. Certains aiment y voir un héritage de Fernand Léger, dont il avait suivi les cours à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ses grands et épais traits noirs qui contraignent une couleur explosive annoncent la forme des graffitis. En ce sens, Maryan est l’un des précurseurs d’une peinture libre et vraie, reconnaissable à son graphisme efficace qui exerce encore aujourd’hui une puissante influence sur les jeunes générations d’artistes contemporains. Une peinture expressionniste que Maryan qualifiait de « peinture-vérité ». En tout état de cause, chez Maryan, l’émotion fait reculer l’horreur.
Depuis une dizaine d’années, les institutions culturelles internationales en ont pris la juste mesure et lui consacrent expositions et publications. Grâce au don réalisé par Annette M. Maryan en 2012, le Centre Pompidou a enrichi sa collection d’une cinquantaine d’oeuvres de l’artiste, parmi lesquels neuf dessins de la série Napoléon. En 2013, le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ), sous le commissariat de Nathalie Hazan-Brunet, lui consacre sa première rétrospective parisienne depuis sa disparition. Le Museum of Contemporary Art North Miami (MOCA) expose actuellement une rétrospective qui sera montrée au Tel Aviv Museum of Art à la fin de l’année 2022. Kamel Mennour a choisi ici de nous faire redécouvrir l’oeuvre de l’un des chefs de file de la Nouvelle Figuration qui traversa le XXe siècle à contre-courant.
À mon ami Antonio Seguí (1934-2022), ami de Maryan, qui s’est éteint le 26 février dernier.
— Lucas Djaou, février 2022.